

Dans un écrin de verdure, à proximité de la fontaine Saint-Iltud [*],
l′église paroissiale de Coadout doit très probablement son patronage à son
appartenance à l′évêché de Dol sous l′Ancien
Régime 1. Abbé-fondateur du
monastère de Llaniltud dans le Glamorgan au Pays-de-Galle
(Grande-Bretagne), saint Iltud fut en effet le maître de saint Samson qui, selon la tradition,
fonda l′évêché de Dol au Vème siècle. Si le culte
de saint Iltud est attesté dans plusieurs paroisses du secteur, à l′instar de
Pabu, Squiffiec ou Landebaëron, la tradition locale rapporte que le saint avait coutume de venir
prier à Coadout en compagnie de saint Briac et qu′à ce titre l′empreinte de ses
genoux est restée gravée dans la pierre d′un ancien dolmen 2.

Fondée par les seigneurs du Bois-de-la-Roche, l′église paroissiale
Saint-Iltud est un édifice du XVIIème siècle, en partie
remanié au XVIIIème siècle et restauré au début
du XXème siècle. Dans sa notice consacrée à la
présentation de l′église 3,
René Couffon relate ainsi que le clocher, placé initialement au centre de
l′église, menaçant de tomber en 1662, il fut décidé la
même année de le déposer et d′en construire un nouveau à
l′ouest. Conçu par les architectes guingampais Alain et Vincent Labat, ce
nouveau clocher fut dressé par Jean Daniel de Coadout. C′est à
l′occasion de ces travaux que furent apposés le cadran solaire, portant
selon René Couffon le millésime 1664, ainsi que les armes de Philippe de
Liscouët, alors seigneur du Bois-de-la-Roche 4.


Toujours selon la même source,
c′est en 1689 que les vitraux furent montés par un dénommé
Lagrange, tandis que la sacristie, reconstruite depuis, fut édifiée en 1697
par Yves Féjan. En souvenir de cette campagne de construction, l′actuelle sacristie
conserve au-dessus de la porte d′entrée l′inscription suivante :
1697 R. FOLLET Rr *
[* Recteur ]

Au cours du XVIIIème siècle, une restauration fut engagée le 10 avril 1768
par les maçons François Piriou, René et Guillaume Daniel,
ainsi que les charpentiers Francois Famel, Jean L′Hostellier et Yves Piriou.
Cette restauration achevée, nous signale René Couffon, une nouvelle
sacristie fut construite en 1772 d′après les plans dressés par
François Le Bihannic. Les travaux furent alors exécutés par
Guillaume Le Flohic sous la direction de l′ingénieur Anfray.
Enfin, le clocher fut restauré au début du XXème siècle,
ainsi que permet de l′attester le millésime 1912 gravé sur un écu.
Les travaux, entrepris sous l′égide de l′abbé Goasdoué, recteur de
la paroisse de Coadout, furent alors réalisés par l′architecte guingampais Georges-Robert
Lefort 5. La bénédiction
de l′église nouvellement restaurée eut lieu le 3 mai 1914.

Au fond d′un vallon, principalement édifiée en moellons de granite, l′église paroissiale
Saint-Iltud occupe la partie méridionale d′un enclos ouvert au nord d′un portail à deux piliers
flanqués autrefois d′un échalierDans
un enclos paroissial, l′échalier désigne un accès barré par une pierre plate
dressée verticalement, facile à enjamber et précédée d′un degré.
Cet échalier préservait ainsi l′espace sacré de toute intrusion animale..
Conçue sur un plan en croix latine, elle est composée
d′une nefPartie d′une
église de plan allongé comprise entre le massif antérieur et le transept ou le choeur. La nef désigne le
vaisseau central. à vaisseau unique, d′un transeptCorps
tranversal formant une croix avec le corps longitudinal de l′église. et d′un choeurPartie
de l′église réservée au clergé. sur lequel est greffée une
sacristieLa sacristie désigne le local où sont entreposés
les vases sacrés, les objets lithurgiques, les vêtements sacerdotaux, etc.
à pans coupésLe pan coupé est la partie d′un mur, peu
développée en longueur, remplaçant en théorie l′angle à la jonction des deux murs.
Chaque pan coupé est ici ajouré d′une baie, à savoir une porte à droite - celle dont le linteau
porte le millésime 1697 - et une fenêtre barreaudée à gauche. De plus, la toiture de la sacristie est
agrémentée d′un égout retroussé
L′égout d′un toit désigne la partie inférieure du versant. Cet égout est qualifié
de « retroussé » lorsque le versant est brisé de façon que la pente de l′égout
soit moins forte que la pente du versant..

A droite du bras du transept, dont la façade antérieure reçoit une porte d′entrée
à traverse d′imposteLa traverse d′imposte
désigne l′élément horizontal d′un bâti dormant divisant la baie.,
l′élévation nord de l′église paroissiale Saint-Iltud
accueille en outre la chapelle des fontsLa chapelle des fonts désigne le lieu
qui accueille les fonts baptismaux ou la cuve au-dessus de laquelle est administré le baptême..
Comme le suggère l′analyse architecturale, étayée par la lecture de
l′extrait du plan cadastral parcellaire de 1822, cette partie de l′église fut
très probablement rapportée aux alentours de 1900.
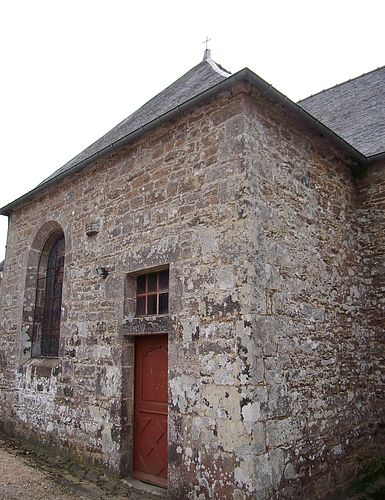

Mais, la particularité de l′église Saint-Iltud tient à
la présence d′un clocher en maçonnerie appartenant à
la catégorie des clochers de « type
Beaumanoir »Du nom de l′atelier morlaisien qui mit au point cette formule
originale à la fin du XVème siècle. Ce modèle de clocher a perduré
en Bretagne jusqu′au XVIIIème siècle, voire au-delà. qui connurent
un succès dans le Trégor à partir de la fin du Moyen Age.

Le massif antérieur de l′édifice consiste, en effet, en une tour centrale
rectangulaire dans-oeuvreSe dit d′un
corps de bâtiment totalement engagé dans un autre corps de bâtiment plus
important flanquée à droite d′un escalier en vis en maçonnerie desservant
un clocher à trois baies. Cette tour est affirmée par deux puissants contreforts
antérieurs qui s′élèvent de part et d′autre de l′entrée
jusqu′à une terrasse en encorbellementSurplomb
allongé porté par une suite de supports (corbeaux, consoles, têtes de solives, etc.)
couronnée d′une balustradeTout garde-corps
formé par une file de balustres est une balustrade. Le balustre est un petit support vertical en
répétition dans un garde-corps. sur modillons agrémentée de
gargouillesConduit d′évacuation des eaux.
en forme de canon.



A l′instar de nombreuses églises de la région, cette tour accueille donc un clocher
à trois baies recevant chacune une cloche. Deux baies jumelées sont ici surmontées
d′une seconde terrasse supportant un campanilePetite
construction de plan centré placée au faîte d′un toit et recevant une cloche.
Cantonnée d′un pinacleUn pinacle est un
amortissement élancé de plan carré ou polygonal terminé en cône ou en
pyramide à chaque angle, cette terrasse est, en outre, agrémentée sur les
quatre côtés d′une balustrade factice formée par une file de balustres reliant
deux corniches moulurées faisant office de socle et d′appui.

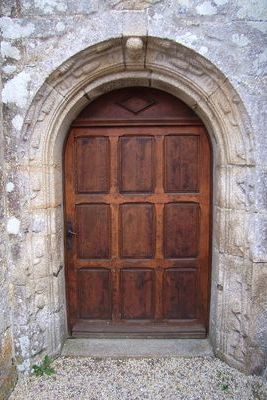

Entre les deux contreforts antérieurs, l′entrée en plein-cintre est surmontée des armes du donateur
Philippe de Liscouet [*] et d′une niche à statue vide
agrémentée d′une consoleUn support de forme quelconque
moulurée et d′un daisLe dais désigne une couverture en
surplomb protégeant l′emplacement réservé à une statue dont la face est ornée
de croix latines en relief. En outre, chaque ébrasement extérieur de la porte est ornée d′un décor
végétal en demi-relief, figurant vraisemblablement des pommes de pins accrochées à une branche dont la
base sort de la bouche d′un batracien, crapaud ou grenouille, pour rejoindre la clé de l′arc ornée
d′un mascaronOrnement représentant une figure humaine.
Ici le sculpteur a manifestement fait preuve de fantaisie, à moins d′avoir répondu à la demande d′un
commanditaire tout aussi fantaisiste.



Près du contrefort antérieur gauche, le regard du visiteur pourra enfin s′arrêter
sur un bénitier, ainsi qu′une ouverture chanfreinée de forme rectangulaire verticale
qui, avant d′être obstruée par l′édification de la chapelle des fonts, permettait
aux lépreux d′assister à l′office. Cette ouverture était de la sorte dénommée
le « trou des lépreux », toul al laour en breton 6.

1. TANGUY, Bernard. Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes-d′Armor : origine et signification. Douarnenez, Ar Men-Le Chasse Marée, 1992, p. 49.
2. Id., p. 49.
3. COUFFON, René. Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1939, p. 83-84.
4. Ces armes figurent également sur les bras nord et sud du transept [*].
5. FLOHIC EDITIONS. Le patrimoine des communes des Côtes-d′Armor. Charenton-le-Pont, Flohic Editions, 1998, vol. 1, p. 386.
6. COUFFON, René. op. cit., p. 84.